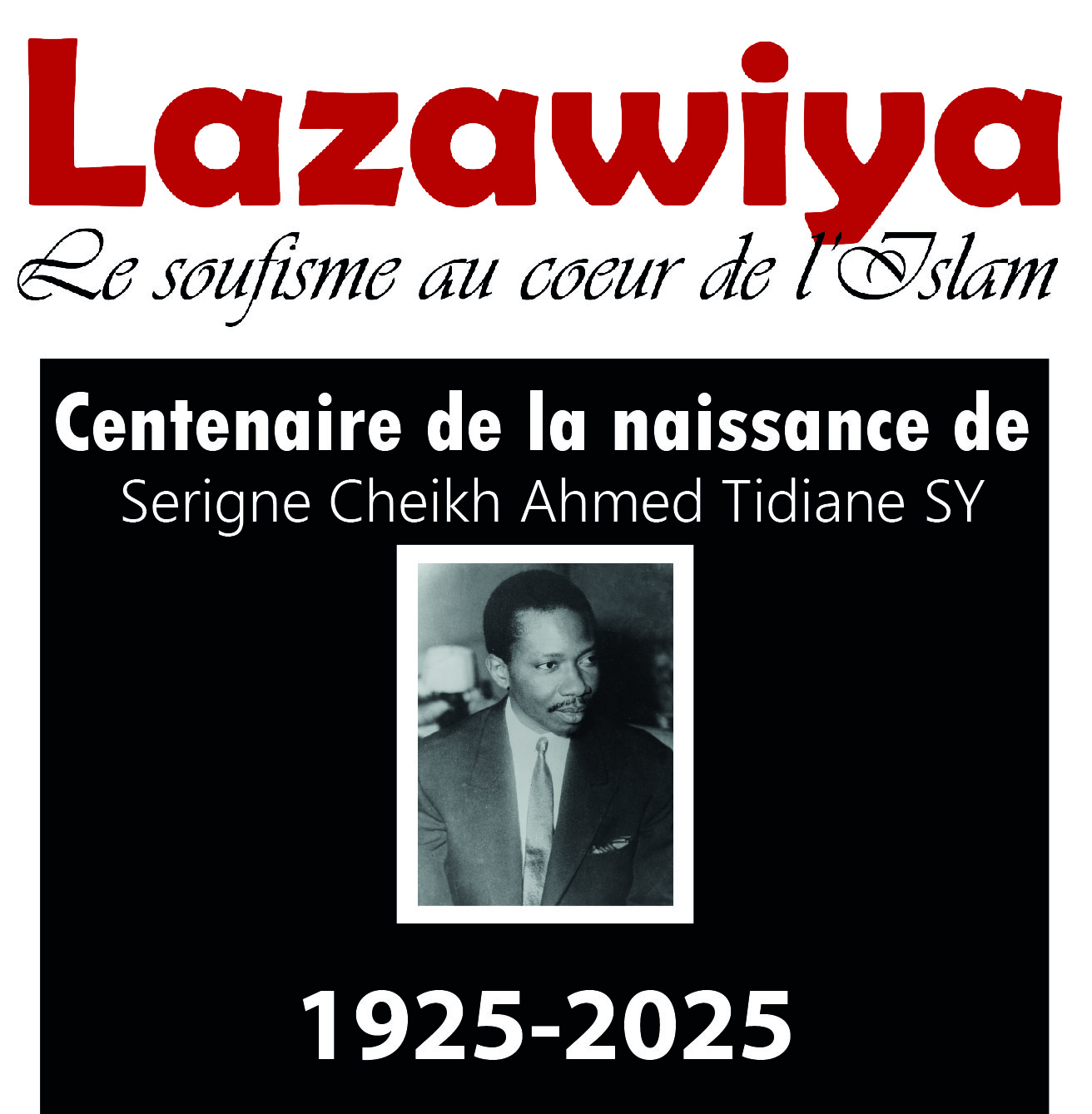Cette approche permet de considérer, sous un jour nouveau, la place d’Ibn ‘Arabī dans la culture musulmane, en montrant que son legs n’appartient pas seulement à l’histoire du soufisme en tant que philosophie mystique, mais investit l’ensemble des « sciences religieuses », y compris le tafsīr et le fiqh. L’étendue de l’influence d’Ibn ‘Arabī sur la pensée légale postérieure est désormais mieux connue grâce à la multiplication des travaux récents sur l’histoire culturelle du monde musulman, et plus spécialement des provinces arabes de l’Empire ottoman, entre le xvie et le xixe siècle : les amples développements qu’Ibn ‘Arabī consacre au fiqh dans son œuvre majeure, les Futūhāt al-Makkiyya, ont marqué la réflexion sur les principes de l’herméneutique légale (usūl al-fiqh) de nombreux « ulama »-soufis de cette époque, contribuant à y maintenir ouverte la réflexion sur l’ijtihād.
Les Futūhāt al-Makkiyya sont certainement la source principale pour l’étude de la pensée légale d’Ibn ‘Arabī. Cependant, les Fusūs al-hikam, synthèse de sa pensée achevée à Damas dans les dernières années de sa vie, méritent aussi bien d’être étudiés sous cet angle : en témoignent les nombreux passages concernant la théorie légale (par ex. Fus.1, p. 62‑63, 95, 135, 156, 163‑164), aussi bien que la réflexion sur la notion de peine qui parcourt l’exégèse des histoires de punition dans le Coran (par exemple les chapitres sur Noé, Hūd, Lot, Jonas). De façon plus générale, le problème du fondement philosophique de la responsabilité légale (taklīf) est au cœur de ce livre, qui explore sous des multiples aspects la tension entre la découverte de la réalité de l’être, dominée par un monisme déterministe, et la soumission à l’ordre moral établi par la révélation.
Les trois chapitres des Fusūs al-hikam sur Jonas, David et Loth, qui ont fait l’objet d’une analyse textuelle détaillée dans trois séances de ce séminaire, ont paru particulièrement pertinents pour dégager quelques enjeux juridiques et politiques de ce livre. Dans ces conférences, on s’est proposé d’évaluer la place de ces textes dans l’histoire de la pensée politico-juridique de l’islam, et non seulement de les lire dans le cadre spécifique de sa doctrine, même si cela reste indispensable. Ibn ‘Arabī est en effet une plaque tournante de la pensée islamique : son œuvre est l’aboutissement de la pensée religieuse de l’islam classique, voire d’une culture engagée dès ses débuts dans un dialogue serré avec les autres religions du Proche‑Orient, et elle constitue à son tour le point de départ d’une tradition interprétative qui s’étend du xiiie siècle à l’époque moderne.
Tout en étant conscient des « dangers » du dévoilement des « secrets » métaphysiques pour l’ordre légal (cf. Fus., p. 109-110, 133), Ibn ‘Arabī exprime dans la préface des Fusūs son souhait d’être le « traducteur » (mutarjim) fidèle du message de Muhammad : il raconte que le Prophète lui‑même lui a consigné le livre lors d’un rêve véridique, lui recommandant de le publier afin que les gens en tirent une « utilité » (Fus., p. 47). Les lecteurs du livre, au fil des siècles, en ont tiré profit de façons très différentes. Ici, nous donnerons une place privilégiée au commentaire sur les Fusūs de ‘Abd al-Ghanī al-Nābulusī (1050-1143/1641-1731), qui aide à en expliciter les conséquences dans le domaine de la morale pratique, allant dans le sens d’une limitation des dimensions coercitives et punitives de la loi et du monopole de son interprétation par l’establishment politico-religieux.
II. Jonas, le talion et l’enfer
Le chapitre sur Jonas a été choisi comme point de départ parce qu’il pose de façon directe et limpide le problème du conflit entre droit et morale dans la sharī‘a, à travers l’exégèse du verset coranique sur le talion (Cor. 42, 40). Dans ce verset, qui autorise la rétribution tout en recommandant le pardon, le talion, remarque Ibn ‘Arabī, est défini comme un « mal » (sayyi’a) tout en étant légal (mashrū‘). Celui qui verse le sang s’oppose en fait à la véritable intention divine, qui est de préserver la vie de l’homme, quel qu’il soit, car Dieu à crée tous les hommes « à son image ».
Ibn ‘Arabī affronte le problème du « mal » dans la loi sans se contenter de la réponse de la théodicée, qui considère la violence comme un mal relatif, justifié par le bien public (maslaha). Son point de vue n’est pas ici celui du défenseur de la justice divine et de ses exécuteurs sur terre, mais celui de l’avocat de l’homme qui est dépourvu de tout pouvoir.
En mettant au centre de son argumentation le cas du talion, qui relève de la justice privée, où on est libre de renoncer à son droit à la vengeance, Ibn ‘Arabī ne semble pas plaider pour une interdiction absolue de verser le sang. Son argument est d’ordre spirituel plutôt que légal : celui qui pardonne, laissant en vie le coupable, lui laisse ouverte la potentialité de réaliser en acte sa ressemblance à Dieu ; et la réalise dès maintenant en lui-même, obtenant la félicité (sa‘āda). Le pardon est donc un choix, une épreuve, mettant l’homme devant sa responsabilité morale.
On trouve toutefois un développement remarquable dans le commentaire de Nābulusī, qui ajoute aux peines dont il faut éviter l’application les hudūd et les peines discrétionnaires (ta‘āzīr) qui comportent qu’on verse le sang. Ce commentateur syrien de l’époque ottomane étend ainsi la réprobation de verser le sang du domaine de la justice privée à celui de la justice publique, s’approchant d’une critique radicale non seulement de la rétribution privée mais aussi de la peine de mort.
Les enjeux soulevés par ce texte ont été éclaircis indiquant des parallèles avec le christianisme : dans celui-ci comme dans l’islam, l’exégèse mystique a tiré du thème de « l’homme à l’image de Dieu » des conséquences éthiques qui vont à l’encontre de la justification de la violence par les tenants de la théologie politique. Cela vaut aussi bien dans le cas des punitions légales que dans celui du châtiment infernal. Comme en témoigne la discussion d’Augustin (Cité de Dieu, 21, 24), selon des interprétations chrétiennes, rejetées par le Père de l’église, le salut in extremis des habitants de Ninive (le « peuple de Jonas » de Cor. 10 :98) prouverait la possibilité que Dieu ne réalise pas sa menace, et, par conséquent, que l’enfer ne soit pas éternel. à la question de l’éternité de l’enfer est dédiée la partie finale du chapitre des Fusūs sur Jonas, qui peut être considérée comme un commentaire indirect d’un verset de la sourate de Jonas, où l’enfer est défini comme un « mal » (sayyi’a) (Cor. 10 :27), ainsi qu’est présenté le talion dans le Coran (42, 40).
III. David et le califat
Le but principal de cette conférence a été de situer l’image de David dans les Fusūs par rapport au rôle de ce prophète dans la pensée politique musulmane. Dans celle-ci, David occupe une position ambivalente. D’une part, il est une figure centrale de la théologie politique. Unissant la prophétie et la royauté, David est, avec Salomon, un symbole du fondement sacré du pouvoir. Il a été, dès l’époque omeyyade, une source de légitimation pour le califat dynastique, et a été reconnu comme un archétype de Muhammad en tant que prophète armé. D’autre part, on retrouve dans les tafsīr-s anciens et les qisas al-anbiyā’ des portraits fort critiques du personnage, expression de l’opposition piétiste à l’idéologie impériale du califat. Les ouvrages sur les preuves de la prophétie, en outre, soulignent la différence entre Muhammad et les prophètes-rois comme David et Salomon, le premier ayant renoncé au royaume de ce monde, préférant la condition de prophète-serviteur à celle de prophète-roi.
On retrouve dans les Fusūs une dense synthèse de cet héritage contradictoire. David est bien ici l’archétype de la « vice-gérance de Dieu dans le jugement » (khilāfa ‘an Allāh fi l-hukm), qui concerne aussi bien l’autorité législative du mujtahid que le pouvoir du souverain, mais Ibn ‘Arabī met en lumière les limites et les dangers de cette dimension du califat. En effet, la vice-gérance légale et politique n’est qu’un aspect limité de la fonction du califat, qui appartient spécifiquement à David mais n’est pas expressément attribué à Adam, qui est, comme tous les autres hommes, « calife » en tant qu’image de Dieu. étant investi de cette responsabilité, David s’expose au danger de manquer à sa tâche aussi bien comme juge que comme chef politique. Par son erreur de jugement, évoqué par le Coran (21 :78-79), il est le modèle de l’ijtihād faillible, validé par la loi même s’il est erroné (Fus., p. 156). Surtout, David est privé par Dieu du droit de construire le Temple car il a versé le sang en combattant « sur Sa voie » (Fus., p. 167). La victoire sur les ennemis de la religion est bien une manifestation de la puissance divine, mais ne réalise qu’un aspect partiel de la volonté de Dieu.
IV. Lot, le miracle et la contrainte
Dans ce chapitre, Ibn ‘Arabī fusionne deux thèmes théologiques qui revêtent une grande importance politique : la discussion sur la valeur du miracle et du succès du prophète en ce monde comme preuves de l’authenticité de sa mission, et le problème de la contrainte dans la religion, discuté dans la riche tradition interprétative sur Cor. 2 :256.
La dialectique de la « force » et de la « faiblesse », en Dieu et dans l’homme, est le thème de fond du chapitre sur Lot, aboutissement d’une série d’histoires de punition qui sont traitées dans les chapitres précédents des Fusūs. Ici, la réflexion sur le pouvoir ne concerne pas l’autorité législative ou politique, mais la puissance destructrice qui est manifestée dans le macrocosme par les anges, et dans le microcosme par les âmes parfaites qui exercent leur influence sur le monde par leur pouvoir de concentration (himma), l’énergie spirituelle qui rend compte des miracles des prophètes et des saints. Les saints et les prophètes dont la connaissance est plus parfaite, évitent cependant d’avoir recours à ces pouvoirs. Muhammad, à la différence de Lot, ne désire par la destruction de son peuple, et, chaque fois que lui en est donné le choix, renonce à exercer des pouvoirs miraculeux. Cette attitude est le fruit de la conscience de la « faiblesse » foncière de l’homme, mais dérive aussi de la connaissance de la nature de la foi, illumination du cœur par Dieu qui ne peut être imposée par aucun pouvoir extérieur, fût-il le miracle. Mais en fait, Dieu lui-même, qui se limite à donner l’existence aux archétypes immuables tels qu’il les connaît dans son essence, n’a pas le pouvoir de contraindre à la foi ou à l’incroyance : cette méditation sur la puissance divine débouche ainsi sur la reconnaissance d’une « faiblesse » qui a ses racines dans le processus de la manifestation divine.
V. La dispute dans le Conseil céleste
Cette conférence a porté sur les exégèses de Coran 38 :69, où il est fait allusion à une « dispute » (mukhāsama) dans le Conseil céleste, que la plupart des commentateurs réfèrent à l’opposition des anges à la création de l’homme, dont il est question en Coran 2 :30.
La dispute des anges joue un rôle important dans les versions rabbiniques du récit de la création d’Adam, tandis que dans les versions chrétiennes orientales de ce récit les anges glorifient l’être créé à l’image de Dieu, et le diable est le seul qui refuse de l’adorer. L’exégèse musulmane, plus proche ici des versions chrétiennes, tend à ignorer ou à marginaliser le thème de la dispute des anges, imputant au seul Iblīs le refus de se prosterner. Cependant, un hadīth qui a été intégré dans le récit du mi‘rāj a permis de récupérer le thème de la dispute, tout en l’atténuant. D’après ce hadīth, pendant son ascension céleste, Muhammad aurait appris de Dieu lui-même que l’objet de la dispute des anges étaient « les expiations et les degrés »2. Le hadīth offre ainsi une explication alternative de l’allusion coranique, détournant la mukhāsama du conseil suprême de ses implications plus dangereuses, tout en conservant le thème du débat céleste. Ainsi interprété, celui-ci perd sa nature conflictuelle pour devenir un modèle de la divergence d’opinions (ikhtilāf) des juristes et de la négociation du prophète avec Dieu lors de son ascension.
Le thème de la controverse dans le ciel est donc ramené à une conception positive du pluralisme juridique et doctrinal à l’intérieur de la communauté (l’aspect souligné par un théologien-juriste comme Fakhr al-Dīn Razi), et même à l’espoir dans l’intercession de Muhammad et dans le triomphe final de la miséricorde divine (l’aspect souligné par un exégète mystique comme Rūzbehān Baqlī).
Ibn ‘Arabī, développe ultérieurement cette tendance interprétative, assignant à la réconciliation de la controverse entre les Noms divins un rôle fondamental aussi bien dans le processus de la création, lorsque l’Essence divine charge le nom Rabb de concilier les propriétés conflictuelles des autres Noms (Futūhāt, chap. 66), que dans l’eschatologie, lorsque le nom Tout-miséricordieux intercédera auprès du nom Vengeur (Fus., p. 64).
source : journals.openedition.org