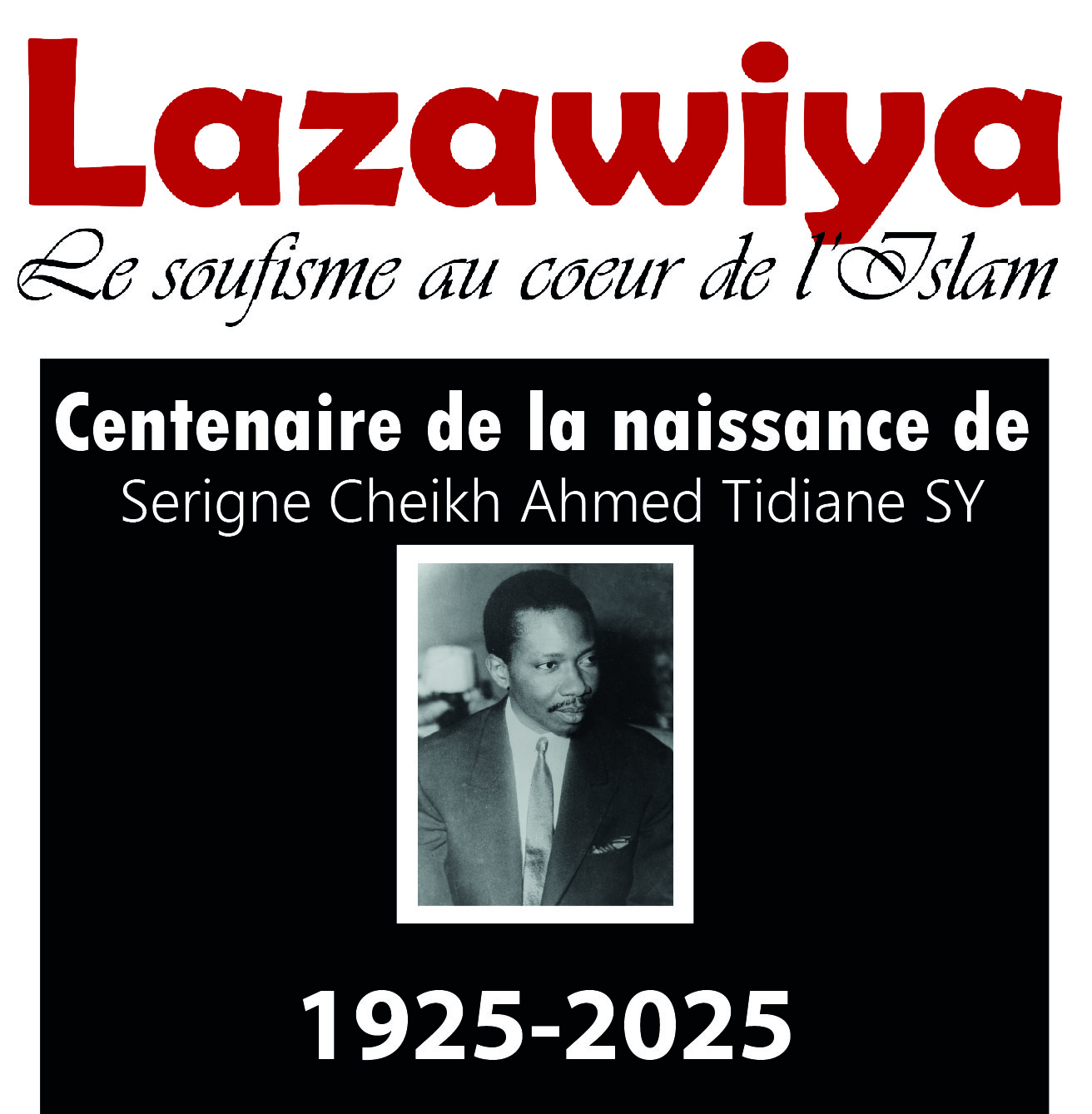2La vie spirituelle est ressentie par le soufi essentiellement comme une lutte contre l’âme charnelle (nafs), siège des passions et des penchants égocentriques, ou contre le soi (persan : khud), individualité illusoire qui s’affirme comme distincte de Dieu, niant ainsi l’Unicité de l’Être. L’un des alliés de l’âme charnelle est le corps, qui n’est pas mauvais en soi, mais qui se laisse instrumentaliser par l’âme pour ses désirs de jouissance matérielle. D’où la nécessité de le “dresser”. Le domestiquer en restreignant les instincts de la vie animale (manger, dormir, se vêtir, avoir des relations sexuelles), c’est acquérir la maîtrise de l’âme (Qushayrî, 1374 H : 165 ; Hujwîrî, 1371 H : 245). En même temps, l’ascèse est censée, par la modification des états de conscience qu’elle entraîne, mener à la contemplation ou à la réalisation intérieure. Pourtant le corps, qui est aussi le véhicule de l’esprit et contribue au service de Dieu, ne doit pas être détruit. Il a besoin d’un minimum de nourriture, de sommeil et de vêtement pour survivre : c’est ce que l’on appellera les ḥuqûq al-nafs, ou les choses “dues” à l’âme. Par contre, dépasser ce strict minimum et s’autoriser un peu plus, c’est tomber dans le domaine des ḥuẓûẓ, des “surplus” (Kâshânî, 1372 H : 280).
3Le regard soufi sur l’ascétisme s’est diversifié et a évolué au cours de l’histoire. Le Prophète lui-même n’était pas un ascète, bien que des hadiths forgés se soient efforcés d’en faire une figure du renoncement. De même, l’islam officiel n’a jamais remis en cause la jouissance mesurée des biens de la création. Pendant les trois premiers siècles de l’Hégire, les guerres et l’enrichissement de l’Umma d’une part, l’exemple chrétien d’autre part, ont provoqué une réaction ascétique chez certains spirituels tels que Ḥasan al-Baṣrî, Ibrahîm al-Adham, Bishr al-Khâfî, ou Abû Sulayman al-Dârânî. Ces auteurs insistent sur l’abandon à Dieu (tawakkul), le jeûne, les veilles, le port de vêtements grossiers et pour certains d’entre eux le célibat. Puis avec Muḥâsibî, l’accent est mis sur l’ascèse intérieure, le renoncement aux désirs (Knysh, 2000 : 8-48).
4Par ailleurs, le savoir-vivre (adab) semble jouer un rôle aussi important que les privations. Il implique un travail positif de perfectionnement des attitudes et de sanctification des activités de la vie quotidienne. Dans son acception la plus ancienne, adab, refait sur le pluriel âdâb de da’b, “usage, habitude”, est un synonyme de sunna et s’applique à une norme pratique de conduite, à la fois louable et héritée des ancêtres. Le soufisme créa très vite son propre code de conduite idéale, un savoir-vivre spécifique se rattachant à trois références : l’exemple du Prophète (hadith et sunna), l’effort indépendant (ijtihâd) des soufis qui créèrent des règles pour la vie en communauté, et le développement d’institutions typiquement soufies (“couvent”, initiation, dhikr et retraite) (Böwering, 1996 : 145). Une littérature spécifique se créa peu à peu, de sorte que la plupart des grands traités de soufisme comportent un chapitre sur le savoir-vivre.
5Nous étudierons une dizaine de textes tirés de manuels de soufisme composés entre le Xe et le XIVe siècle, et consacrés à l’ascèse corporelle et au savoir-vivre relatif à la satisfaction des besoins matériels essentiels de l’homme : la nourriture, le sommeil, le vêtement et la vie sexuelle. Ces textes se caractérisent par la mesure et l’équilibre, parce qu’ils s’adressent à un public relativement large. Leur objectif est de fixer un minimum à respecter, et donc de proposer un régime praticable par tous les tempéraments et toutes les santés normales. Abû Naṣr al-Sarrâj (m. 378/988), auteur d’un des premiers traités sur le soufisme qui nous soit parvenu, le Kitâb al-Lumac, est un adepte de la tendance “sobre” du soufisme iraqien personnifié par Junayd. Ses visées sont à la fois didactiques et apologétiques : il s’efforce de démontrer que le soufisme s’enracine dans la tradition musulmane primitive et qu’il consiste essentiellement en un respect scrupuleux de la loi et de l’imitation du prophète. L’adab y joue donc un rôle important ; il englobe à la fois les obligations religieuses, les pratiques spécifiquement soufies, la vie sociale, et les codes qui régissent les actes de la vie quotidienne. Les passages qui nous intéressent, consacrés à la nourriture et au vêtement, se composent essentiellement de paroles ou d’anecdotes relatées à propos des premiers soufis, dont on peut déduire une ligne de conduite sévère. Le Kashf al-Maḥjûb li Arbâb al-Qulûb de Hujwîrî (m. 465/1073), originaire des environs de Ghazna, est le premier exposé sur le soufisme en persan et une excellente source à la fois sur les premiers siècles de l’histoire du soufisme et sur la doctrine et les pratiques soufies, présentées de manière très personnelle. Une nouvelle compréhension de l’adab s’y impose, beaucoup plus étroite, limitée aux règles de vie quotidienne et de conduite fraternelle. Hujwîrî conseille la simple modération en matière d’alimentation, discute des divergences des soufis à propos du sommeil ou de la veille, et conseille le célibat. Kimyâ-ye sacâdat du célèbre théologien et philosophe khorassanien Abû Hâmid al-Ghazâlî (m. 501/1111) est un abrégé en persan de sa somme Iḥyâ culûm al-dîn, mais destiné à un plus large public et d’une tendance mystique plus affirmée. Le savoir-vivre lié à la consommation d’aliments y est particulièrement bien traité, avec un luxe de détails. Bien que truffé de références au Coran et à la Tradition, le texte, bien rédigé et peu anecdotique, est original et apporte de nouveaux éléments. Dans l’Âdâb al-Murîdîn d’Abû’l-Najîb al-Suhrawardî (m. 563/1168), originaire du Nord-Ouest de la Perse (m. 563/1168), toute la présentation du soufisme est subordonnée au concept d’adab. Il en va de même chez son neveu Shihâb al-dîn Abû Ḥafs cUmar al-Suhrawardî (m. 632/1234), initiateur de la confrérie Suhrawardiyya. Celui-ci développe la règle établie par son oncle dans son célèbre traité des cAwârif al-Macârif et présente la première organisation rigoureuse du quotidien d’un couvent (ribâṭ). Il ne se borne pas à collecter et classer les dits des premiers maîtres ; il propose une méthode spirituelle et une réflexion sur le soufisme. Son ouvrage sera rapidement traduit et aura une énorme influence dans l’ensemble du monde islamique. Il inspirera notamment le Suhrawardi cIzz al-dîn Kâshânî (m. 735/1335), auteur du Miṣbâḥ al-Ḥidâya wa Miftâḥ al-Kifâya, une brillante adaptation persane des ‘Awârif, remarquable par son esprit méthodique. Un chapitre spécifique y est consacré à la satisfaction des besoins essentiels (sommeil, nourriture, vêtement). L’Âdâb al-Murîdîn de Najm al-dîn Kubrâ (m. 618/1221), le fondateur éponyme de la confrérie Kubrâwiyya, nous fournit surtout des informations précieuses sur les vêtements, le symbolisme des couleurs et des accessoires en rapport avec les états spirituels. Il contient en outre un chapitre intéressant sur la nourriture, où apparaissent certaines coutumes spécifiquement persanes. Il fut peu diffusé et les préceptes énoncés par le maître semblent n’avoir eu qu’une influence limitée sur la vie de sa confrérie. Il inspira au moins certains passages de Awrâd al-Aḥbâb wa Fuṣûṣ al-Âdâb du Kubrawi Abû’l-Mafâkhir Yaḥyâ Bâkharzî (m. 735/1335), notamment sa réflexion sur le symbolisme du vêtement. Ahmad Rûmî (XIVe s.), originaire d’Asie Mineure, est un maître spirituel dans la lignée de la confrérie mevlevie mais probablement sans lien institutionnel avec elle. Il vécut en Inde et composa, entre autres, le Daqâyeq al-ṭarîq, qui comprend une copieuse partie consacrée à l’éthique du soufi (vie au couvent, exercices, étapes du cheminement), illustrée de citations coraniques, de hadiths et de récits édifiants. Atypique pour son époque, cet ouvrage rappelle plutôt les traités soufis des Xe et XIe siècles.
La nourriture
6L’idéal serait évidemment de ne pas manger du tout. La littérature soufie abonde d’ailleurs d’anecdotes hagiographiques mettant en scène des saints capables de jeûner quarante jours ou de s’abstenir de manger pendant des années ou encore de se nourrir de terre ! Ce n’est cependant pas le lot du commun des mortels. Aussi certains auteurs vont-ils s’efforcer de justifier la prise de nourriture.
7Muḥammad Ghazâlî explique que l’adoration et le service de Dieu - que ce soit spirituellement par l’acquisition de la Connaissance (cilm) ou physiquement par des actes (camal) - passent par le corps, et il est donc nécessaire que celui-ci soit en bonne santé. Par conséquent, on a le devoir de lui fournir nourriture et boisson en quantité suffisante (Ghazâlî, 1371 H : 284). Pour cUmar Suhrawardî, le corps est la monture du cœur, et Dieu a créé les plantes et les animaux pour le sustenter. La nourriture contient les quatre éléments (chaud, humide, froid, sec) qui doivent s’équilibrer pour que le corps soit sain. Le bon état du corps permet de s’adonner pleinement à l’adoration (cibâda) (Suhrawardî, 1983 : 341). Il ne faut donc manger que pour apaiser la faim et donner son dû à l’âme charnelle. Certains maîtres, cités par Abû’l-Najîb Suhrawardî et Bâkharzî, ont préconisé de manger comme le malade qui prend un remède pour recouvrer la santé (Suhrawardî, 1363 H : 269 ; Bâkharzî, 1358 H : 137). La nourriture doit être licite (ḥalâl) et il ne faut pas perdre de vue le Bienfaiteur au-delà du bienfait. Il convient également de respecter les bonnes manières liées à la consommation d’aliments. Celles-ci s’appuient sur des coutumes prophétiques qui les légitiment. La faim modérée possède, quant à elle, une valeur intrinsèque : elle rend l’âme charnelle obéissante, humble et sincère, et elle épargne à l’homme les souffrances au jour de la Résurrection (Suhrawardî, 1363 H : 271 ; Bâkharzî, 1358 H : 140 ; Hujwîrî, 1371 H : 453).
8Faute de jeûner continuellement, on ne mangera que lorsque l’on aura très faim et l’on s’arrêtera avant d’être complètement rassasié. On se contentera de peu et l’on s’efforcera de ne pas y prendre de plaisir (Sarrâj, 1914 : 182 ; Ghazâlî, 1371 H : 288 ; Suhrawardî, 1983 : 349 ; Kâshânî, 1372 H : 274). On ne simulera pas pour autant l’abstinence. Le repas doit être le plus frugal possible : dans la mesure où il y a du pain, on s’en contentera et l’on ne convoitera pas de mets plus recherchés. Cependant, on pourra également consommer du yaourt, des dattes, des légumes et même de la viande, ou tout autre met offert, à condition bien sûr qu’il soit pur rituellement. Aucune nourriture n’est interdite stricto sensu ; il est seulement conseillé de ne pas manger de plats confectionnés par les femmes à cause de leur raffinement excessif (Bâkharzî, 1358 H : 138). Il est préférable de ne pas avoir de temps déterminé pour manger. On préfèrera une nourriture peu abondante, mais pure, à un repas copieux mais douteux. Le soufi ne s’inquiètera pas pour sa subsistance, ne passera pas trop de temps à chercher son pain quotidien et ne fera pas de réserves. Qu’il ne pense pas à la nourriture en dehors des repas (Sarrâj, 1914 : 182 ss ; Suhrawardî, 1363 H : 269 ; Kâshânî, 1372 H : 138).
9Le repas est sanctifié par des rites et des prières. On commencera par une sorte d’ablution en se lavant les mains et la bouche, afin de recevoir le bienfait qu’est la nourriture avec de bonnes manières, ce qui est aussi une façon de remercier (Ghazâlî, 1371 H : 284 ; Kubrâ, 1363 H : 33 ; Suhrawardî, 1363 H : 343). On invoquera ensuite le nom de Dieu, comme le recommandent le Coran et le hadith, et l’on formulera l’intention (niyya) de manger pour renforcer sa foi et non pour satisfaire ses sens. Certains auteurs triplent l’invocation du Nom et préconisent de dire « Au nom de Dieu » à la première bouchée, “Au nom de Dieu le Clément” à la seconde et “Au nom de Dieu le Clément le Miséricordieux” à la troisième. Durant toute la durée du repas, le cœur doit être présent à Dieu, et la langue ne doit cesser de Le commémorer silencieusement. Plus la présence à Dieu est forte, plus la nourriture est illuminée et moins elle est nocive (Ghazâlî, 1371 H : 285ss ; Suhrawardî, 1363 H : 268 ; Kubrâ, 1363 H : 33 ; Hujwîrî, 1371 H : 454 ; Suhrawardî, 1983 : 343ss). Avant de boire, il faut également invoquer le nom de Dieu, et cela même trois fois : à la première gorgée, dire “Louange à Dieu”, à la seconde “Louange à Dieu le Seigneur des mondes”, à la troisième “Louange à Dieu le Seigneur des mondes le Clément le Miséricordieux” (Suhrawardî, 1983 : 349 ; Bâkharzî, 1358 H : 143). Le repas se termine avec la formule “Louange à Dieu”, des prières spéciales si la nourriture était douteuse, et de nouvelles ablutions (Ghazâlî, 1371 H : 287 ; Suhrawardî, 1983 : 350 ; Suhrawardî, 1363 H : 268 ; Kubrâ, 1363 H : 33 ; Hujwîrî, 1371 H : 454 ; Bâkharzî, 1358 H : 139 ; Kâshânî, 1372 H : 274).
10On en vient ensuite à des règles de savoir-vivre qui découlent soit de l’exemple du Prophète, soit du bon sens et d’une élémentaire délicatesse. Il est préférable de servir les mets sur une nappe plutôt que sur un plateau ou une table, car il s’agit là d’une tradition du Prophète. Cependant manger à table ou dans un récipient individuel n’est pas formellement interdit. On s’assoira dans la position du serviteur, c’est-à-dire accroupi sur la cuisse gauche avec le genou droit relevé et sans appui. On évitera de manger seul, car plus il y a de convives, plus la bénédiction est grande. Il est de l’habitude des soufis de manger ensemble, qu’ils vivent ou non en couvent. À des gens qui se plaignaient de manger sans jamais être rassasiés, le Prophète conseilla de se réunir et d’invoquer le nom de Dieu. Il est même préférable de manger avec les frères plutôt qu’en famille (Ghazâlî, 1371 H : 284 ; Suhrawardî, 1983 : 347 ; Suhrawardî, 1363 H : 270 ; Kubrâ, 1363 H : 33 ; Hujwîrî, 1371 H : 454 ; Bâkharzî, 1358 H : 139 ; Kâshânî, 1372 H : 271).
11On se servira de la main droite et l’on saisira les morceaux avec trois doigts. On commencera et finira par du sel. Cette coutume est censée écarter les maladies. On rompra le pain avec les deux mains, on prendra de petites bouchées, on mâchera avec soin et on attendra d’avoir avalé pour prendre une nouvelle bouchée. On mangera ce qui est devant soi, sans puiser au milieu du plat ni choisir les meilleurs morceaux. On n’utilisera pas de couteau pour couper le pain ou la viande. Si quelque chose tombe, on le ramassera et on le consommera après l’avoir essuyé. On ne soufflera pas sur un plat trop chaud, mais on attendra qu’il refroidisse. Si l’on mange des aliments quantifiables (olives, dattes, abricots…), on en prendra un nombre impair, par égard à l’Unicité divine (les nombres impairs évoquent le premier d’entre eux, le un qui renvoie à l’unicité de Dieu, tandis que les nombres pairs évoquent la dualité et donc la multiplicité de la création). Lorsque l’on mange des fruits à noyau, on ne remettra pas les noyaux dans le plat, on ne les recrachera pas dans la paume de la main, mais on les déposera sur le dos de la main et on les jettera de cette manière. On ne critiquera jamais un plat, ni on ne le louera particulièrement. Servir du vinaigre et des herbes potagères est une coutume prophétique. Si l’on se sert d’une assiette ou d’un bol, on n’y mettra que ce que l’on peut manger et on s’efforcera de ne pas laisser de restes (Ghazâlî, 1371 H : 285 ; Suhrawardî, 1983 : 348ss ; Suhrawardî, 1363 H : 270 ; Kubrâ, 1363 H : 33 ; Hujwîrî, 1371 H : 454 ; Bâkharzî, 1358 H : 139 ; Kâshânî, 1372 H : 273ss).
12La boisson est également réglementée. Il faut éviter de boire beaucoup en mangeant. On boit accroupi, les orteils du pied droit sur le pied gauche, ou bien debout à l’exemple du Prophète et de cAlî, mais jamais assis ni étendu. On relève ses manches et l’on se ceint les reins. On prend la cruche de la main droite et après avoir invoqué le nom de Dieu, on boit régulièrement à petites gorgées, puis l’on remercie Dieu. Si l’on éprouve le besoin de boire beaucoup, on le fera en trois fois. On évitera de répandre de l’eau, de prendre la cruche avec des mains sales, d’y poser des lèvres souillées et de roter ! (Ghazâlî, 1371 H : 286 ; Kubrâ, 1363 H : 33 ; Hujwîrî, 1371 H : 454)
13Enfin, on s’arrêtera de manger avant d’être complètement rassasié. On nettoiera les récipients avec les doigts, on se lèchera les doigts avant de les essuyer, on enlèvera soigneusement les miettes. On se curera les dents : ce qui part spontanément sera avalé, ce qui sera enlevé à l’aide du cure-dent sera jeté. On prononcera ensuite la formule de bénédiction. On se lavera les paumes des mains et les doigts en commençant par la droite et l’on se rincera la bouche. Avec l’eau, on peut utiliser l’ushnân, un succédané du savon. Le préposé au lavement des mains présente le bassin en premier lieu à celui qui a la préséance dans l’assemblée, et si tous sont égaux, il commence par la droite. Accroupi avec les orteils du pied droit sur le pied gauche, il tient la cruche de la main droite et le savon de la main gauche. S’il n’utilise pas la main gauche, qu’il la mette derrière son dos afin de marquer la différence avec le service de Dieu (qui nécessite les deux mains). Il verse l’eau parcimonieusement de manière à ne pas la gaspiller, et prie pour être purifié. Les convives se lavent les mains assis sur leurs talons et rentrent ensuite leurs mains dans leurs manches (Ghazâlî, 1371 H : 287 ; Suhrawardî, 1983 : 349 ; Suhrawardî, 1363 H : 270 ; Kubrâ, 1363 H : 34 ; Bâkharzî, 1358 H : 142 ; Kâshânî, 1372 H : 274).
14Si l’on mange en compagnie, d’autres règles de savoir-vivre entrent en jeu. On respectera la préséance en matière d’âge, de sagesse ou de piété. On ne commencera pas avant le muqaddam ou le shaykh, de même que les compagnons ne commençaient pas avant le Prophète. De son côté, celui qui préside ne fera pas attendre ses compagnons, leur offrira les meilleurs morceaux, les invitera à manger (pas plus de trois fois). Il évitera de manger moins que d’habitude, ce qui serait de l’hypocrisie, ne se forcera pas non plus, mais agira conformément à ses besoins du moment. Il est cependant permis de manger moins pour en laisser davantage aux autres, ou plus pour les encourager à manger à leur faim. Personne ne s’arrêtera de manger avant les autres, afin de ne pas leur faire honte et de ne pas écourter leur repas (Ghazâlî, 1371 H : 288 ; Suhrawardî, 1983 : 349 ; Suhrawardî, 1363 H : 270 ; Kubrâ, 1363 H : 34 ; Hujwîrî, 1371 H : 455 ; Bâkharzî, 1358 H : 139 ; Kâshânî, 1372 H : 274).
15Le soufi n’invitera pas ses frères à manger quand on apporte le repas, car tous sont égaux devant cette nourriture qui ne leur appartient pas. Seul le cheikh peut inciter le disciple à manger, pour l’encourager et non parce qu’il estimerait être le donateur. Par contre, dans le monde, il est d’usage d’inviter explicitement les personnes présentes. Certains cheikhs ont conseillé de manger sans cérémonie avec les proches, avec savoir-vivre avec les étrangers, et en préférant l’autre à soi (îthâr) avec les derviches (Suhrawardî, 1363 H : 270 ; Bâkharzî, 1358 H : 138).
16Le soufi regardera devant soi, il ne fixera pas son voisin et ne s’intéressera pas à ce qu’il mange. Il ne fera rien de repoussant, comme plonger la main trop profondément dans le plat, y remettre quelque chose, postillonner, cracher en public, mettre sa main sale dans le sel ou tremper son pain dans le vinaigre ou le bouillon, etc. Il ne restera pas silencieux pendant le repas, car c’est la coutume des Persans (allusion à une coutume zoroastrienne apparue à l’époque sassanide qui consistait à observer le silence pendant les repas, entre deux prières, le bâj giriftan), mais il entretiendra une conversation agréable et pieuse et évitera d’offenser ses compagnons par des paroles maladroites ou malveillantes. Seul Najm al-dîn Kubrâ et cAnṣârî préconisent le silence à table : on ne parlera pas et on évitera de faire du bruit avec les récipients. Tous les convives se lavent les mains dans un même bassin, et non individuellement comme le font les Persans (Ghazâlî, 1371 H : 293 ; Suhrawardî, 1983 : 352 ; Suhrawardî, 1363 H : 272 ; Kubrâ, 1363 H : 35 ; Kâshânî, 1372 H : 275, Böwering, 1984 : 81-83).
17Inviter un ami ou un frère en religion à dîner apporte une plus grande récompense que l’aumône rituelle et éloigne de l’enfer. L’on ne sera pas jugé pour la nourriture que l’on prend dans trois cas : le suḥûr (repas léger pris à la fin de la nuit avant le commencement du jeûne), l’ifṭâr (rupture du jeûne) et le repas pris avec un invité. Ce n’est pas pour autant que l’on fera exprès d’arriver chez quelqu’un à l’heure du repas. Si cela se produit par hasard, on attendra d’en être prié avant de rejoindre les convives, à moins qu’il ne s’agisse de proches. Par contre, si l’on est invité, on ne se fera pas prier, et l’hôte de son côté ne fera pas de cérémonies (takalluf) : il ne donnera que ce qu’il a de prêt, n’empruntera pas et ne privera pas sa famille pour honorer son convive (Ghazâlî, 1371 H : 290 ; Suhrawardî, 1983 : 351 ; Kâshânî, 1372 H : 275).
18Par contre, si on lance une invitation, il convient de traiter ses convives du mieux que l’on peut, tout en leur assurant la licéité de la nourriture présentée et en respectant les heures de la prière. On n’invitera que des gens de bien (ahl-i salâḥ) et des pauvres, sans oublier les proches et les amis. On invitera pour respecter la tradition et non pour faire parler de soi. De même, si l’on est invité, la Sunna veut que l’on accepte, surtout s’il s’agit d’un repas de fête (mariage, circoncision). Si l’on refuse par orgueil, c’est un péché ; si on le fait par hypocrisie, c’est également répréhensible, mais moins que l’orgueil. Celui qui accepte une invitation ne doit pas discriminer le pauvre, ni accepter pour satisfaire son estomac. Il ne refusera pas sous prétexte que la route est pénible ou qu’il jeûne. Par contre, si l’hôte est débauché, cruel ou orgueilleux, si ses biens sont mal acquis, si la fête risque d’être une occasion de chute à cause de la présence d’objets illicites (peintures, soie, or) ou de divertissements interdits (concerts, bouffons, présence de femmes, consommation de vin), il doit refuser et s’excuser poliment (Ghazâlî, 1371 H : 293 ; Suhrawardî, 1983 : 352 ; Suhrawardî, 1363 H : 272 ; Kâshânî, 1372 H : 275).
19Il n’arrivera ni en avance ni en retard et s’installera là où le placera son hôte, sans chercher à occuper la meilleure place. On lui indiquera l’emplacement des toilettes et la direction de la qibla. Il conversera avec les personnes auprès de lui. S’il s’aperçoit de quelque chose d’interdit (munkir), il le signalera, et si rien n’est fait pour y remédier, il partira sans hésitation. Il ne fera pas traîner le repas en longueur, mais ne se précipitera pas non plus pour vider un plat avant que tout le monde ne soit servi et rassasié. On n’emportera pas les restes à moins que cela ne soit proposé par l’hôte. Celui-ci aura bien soin de mettre de côté la part des gens de la maison afin qu’ils n’en veuillent pas aux invités. On ne se retirera qu’avec la permission de l’hôte, qui de son côté devra raccompagner son invité. L’hôte restera toujours poli et de bonne humeur, sans manifester son impatience ou son mécontentement face à un comportement inapproprié. L’invité ne doit pas s’attarder, ni regarder curieusement autour de lui et s’enquérir des objets qu’il aperçoit. L’hôte ne doit pas amener ses enfants pour les faire embrasser, ni inviter trop de personnes à la fois, ce qui est fatigant pour certains convives (Ghazâlî, 1371 H : 293 ; Kubrâ, 1363 H : 34-35 ; Hujwîrî, 1371 H : 455 ; Kâshânî, 1372 H : 281).
Le sommeil
20Pour le sommeil comme pour la nourriture, un certain décalage est perceptible entre un idéal d’ascèse austère illustré par les exemples de spirituels priant sans cesse et ne s’autorisant que quelques brefs instants de sommeil, et une règle finalement très libérale, se limitant à déconseiller les excès. Les auteurs reconnaissent que le sommeil est absolument nécessaire à l’être humain. Si l’on s’en prive totalement, le caractère et l’équilibre des humeurs s’en trouvent perturbés, les forces s’amenuisent et les facultés intellectuelles sont paralysées. Le temps de sommeil optimal est d’un tiers de la journée, soit huit heures : rien donc d’héroïque ! L’été, lorsque les jours sont plus longs, on dormira six heures pendant la nuit et deux heures durant la journée. L’hiver, la totalité du sommeil s’effectuera la nuit. Il ne faut dormir ni plus ni moins, sous peine de voir sa santé affectée (Suhrawardî, 1983 : 362 ; Kâshânî, 1372 H : 281).
21Il existe différentes sortes de dormeurs. Celui qui dort pour Dieu (lillâh) prend juste ce qu’il faut de sommeil pour pouvoir accomplir ses dévotions obligatoires et surérogatoires (farâ’iḍ wa nawâfil). Celui qui dort par Dieu (billâh) ne s’endort qu’assommé par la fatigue ; il se restreint donc davantage que le premier. Enfin l’ignorant (ghâfil), inconscient du but de sa venue dans ce monde, dort hors de Dieu (can Allâh). Que l’on dorme pour Dieu ou par Dieu, mais non hors de Dieu (Suhrawardî, 1363 H : 273).
22Diminuer le temps de sommeil sans nuire à son équilibre physique et mental s’effectue de deux manières. Soit on s’habitue progressivement à dormir de moins en moins longtemps. C’est la méthode active qui nécessite un effort conscient de la volonté propre. Soit on bénéficie d’un don divin, accordé à ceux qui ont un ardent désir de Dieu et leur permettant de se consacrer davantage à la prière sans se fatiguer outre mesure. C’est ainsi que certains grands mystiques n’ont pas dormi pendant des années (Kâshânî, 1372 H : 282).
23Si l’on veille, c’est pour prier, commémorer Dieu (dhikr) et réciter le Coran, jusqu’à ce que l’on soit vaincu par le sommeil. Certains soufis arrivaient à veiller toute la nuit, d’autres un tiers de nuit, d’autres encore un sixième de la nuit. Suhrawardi propose de dormir pendant le premier tiers, de veiller ensuite la moitié de la nuit, puis de se rendormir pour un sixième, ou inversement. Il fut conseillé à David de veiller au milieu de la nuit et non pas au début ou à la fin : ce qui est important, c’est donc non seulement de réduire le sommeil, mais encore de l’interrompre, ce qui assurément est plus pénible (Suhrawardî, 1983 : 364 et 369).
24En réalité, il existe des divergences entre les soufis quant à la conduite à adopter par les disciples. D’après Hujwîrî, ces différences dépendent de l’appartenance des différents maîtres à la doctrine de l’ivresse (sukr, ceux-ci recommandent de veiller) ou à celle de la sobriété (ṣaḥw, ceux-là autorisent le sommeil). Les premiers estiment que l’on ne doit s’endormir que vaincu par le sommeil, car les miracles sont accomplis à l’état de veille, et parce que le sommeil est inexistant au paradis. Pour Shiblî, celui qui dort est insouciant, donc voilé. Les seconds pensent que le novice peut dormir quand il le souhaite et même se contraindre à prendre du repos, une fois les prescriptions divines honorées. Ils s’appuient sur un hadith : les mauvaises actions du dormeur ne seraient pas prises en compte par la justice divine. Junayd est le porte-drapeau de ce groupe : le sommeil est un don de Dieu à ses créatures, il ne dépend pas de leur volonté, mais de Dieu ; il est donc supérieur à la veille, qui procède de notre volonté. D’ailleurs les visions des saints et des prophètes adviennent le plus souvent durant le sommeil. Pour Hujwîrî, c’est l’absence de volonté propre qui fait le mérite d’une attitude : le bénéfice revient non à l’homme qui se force à rester éveillé, mais à l’homme qui est maintenu en éveil (par Dieu) ; de même le mérite ne revient pas à l’homme qui se force à dormir, mais à l’homme que l’on endort. Par ailleurs, lorsqu’une personne parvient à un niveau tel que sa volonté n’existe plus et que ses pensées se détournent de tout ce qui n’est pas Dieu, peu importe qu’elle dorme ou qu’elle veille (Hujwîrî, 1371 H : 457-461).
25La position du sommeil est réglementée. Il faut dormir tourné vers la qibla, sur le côté droit (c’est ainsi que l’on enterre le défunt) ou bien sur le dos (comme le mourant), car le sommeil est une petite mort. Il ne faut d’ailleurs s’abandonner au sommeil que comme si l’on s’apprêtait à rendre l’âme, après s’être repenti de ses péchés et avoir réglé ses différends ainsi que les affaires en suspens. Des prières spéciales doivent être dites et deux rak‘a-s effectuées. On ne dormira pas sur le dos si l’on ronfle et l’on évitera à tout prix de dormir sur le ventre. Il est préférable d’abandonner les habitudes d’aise, telles que dormir dans un lit avec un oreiller et une couverture. Certains grands mystiques ne s’étendaient jamais, mais se contentaient de s’appuyer contre un mur, lorsque le sommeil les submergeait. On mangera légèrement le soir et l’on s’endormira en état de pureté rituelle afin d’éviter les rêves inopportuns et de se préparer à la vision (ru’ya). L’homme marié qui dort avec son épouse et la touche par inadvertance ne perd pas le bénéfice de son ablution s’il n’en éprouve pas de plaisir. Si l’on se réveille pendant la nuit, on se tournera immédiatement vers Dieu et l’on effectuera quelques rak‘a-s surérogatoires. Il est haïssable de dormir après la prière de l’aube et après celle du coucher de soleil, ou de se rendormir après s’être réveillé. De même, il ne convient pas de s’endormir en société : que l’on lutte contre le sommeil en discutant ou que l’on rentre chez soi (Suhrawardî, 1983 : 364-369 ; Suhrawardî, 1363 H : 273 ; Hujwîrî, 1371 H : 461-462 ; Kâshânî, 1372 H : 282).
Le vêtement
26Le vêtement est à la fois un commandement divin (cacher sa nudité) et un besoin légitime de l’âme (se protéger du froid et de la chaleur). L’âme ayant tendance à réclamer du superflu, il faut être attentif à ne pas outrepasser ces finalités basiques. Pourtant le vêtement doit être adapté à l’état spirituel de celui qui le porte : on évitera de porter des vêtements misérables alors que l’on n’a pas atteint la pauvreté spirituelle (faqr), afin de ne pas faire illusion (Suhrawardî, 1983 : 353 ; Suhrawardî, 1363 H : 265 ; Kâshânî, 1372 H : 275).
27Au début, il existe une grande liberté dans l’usage du vêtement, les seuls impératifs étant que le vêtement soit conforme à la Sunna (licite) et pur rituellement. Il est aussi vivement conseillé de ne porter qu’un seul et unique vêtement, été comme hiver. Certains portent des vêtements grossiers, un froc (khirqd), éventuellement fait de nombreux morceaux (muraqqaca) ; d’autres s’en abstiennent par modestie, pour ne pas se distinguer du commun. Sulayman al-Dârânî portait une chemise blanche. Yaḥyâ ibn Mucadhdh porta d’abord de la laine et des vêtements usés, avant de s’autoriser la soie grège et les vêtements délicats sur la fin de sa vie, ce qui lui attira les vives critiques d’Abû Yazîd, qui ne portait qu’une tunique, et encore empruntée ! En réalité, l’homme sincère est honorable quoi qu’il porte, l’essentiel étant de n’avoir ni habitudes ni préférences vestimentaires. On s’en remettra à Dieu et l’on portera ce que l’on aura sous la main : de la laine, du feutre, un froc rapiécé de préférence, ou des vêtements plus élaborés si l’on ne trouve pas autre chose (Sarrâj, 1914 : 187-189 ; Suhrawardî, 1363 H : 265).
28On évitera cependant de porter des vêtements très raffinés, sauf cas exceptionnel justifié par un état spirituel particulier. On s’abstiendra également des vêtements porteurs d’une bénédiction particulière (tabarruk) comme ceux qui évoquent la qualité de cheikh, ou la toge du pèlerinage (iḥrâm), car cela attire le respect et risque de flatter la vanité. Revêtir un vêtement un peu meilleur est une tolérance (rukhṣa), car il est dit que Dieu est beau et aime la beauté, mais il ne faut pas agir par amour du monde, vanité ou désir de la louange des hommes. Tout dépend de l’état de la personne : si elle est sainte, sa manière d’user du vêtement est saine (Suhrawardî, 1983 : 353-359 ; Suhrawardî, 1363 H : 265-266).
29Avec l’institutionnalisation du lien entre le disciple et le maître dès le XIIe siècle et même le XIe siècle dans le monde persan, c’est le froc de laine qui s’impose comme le meilleur vêtement des soufis, car d’après la Tradition, c’est ce qu’ont porté Adam et Eve, ainsi que les prophètes Moïse, Jean-Baptiste et Muḥammad. Celui qui devient novice et veut porter le froc des soufis doit impérativement le recevoir d’un maître qui possède à la fois la loi religieuse (sharîcat), l’effort spirituel (ṭarîqat) et la vérité divine (ḥaqîqat). Il ne recevra le froc lors d’une cérémonie spéciale que lorsque son cheikh sera sûr qu’il pourra assumer toutes les difficultés de la voie. Car, s’il s’en détourne après s’y être engagé, il sera considéré comme un renégat de la pire espèce (Kubrâ, 1363 H : 27). Cette ritualisation du vêtement va favoriser l’éclosion d’un symbolisme des couleurs, matières et éléments de la tenue vestimentaire qui part du postulat selon lequel l’apparence extérieure (ṣûrat) doit correspondre à la réalité intérieure (ma nî) de l’homme.
30Pour des auteurs comme Anṣârî, Kubrâ, Bâkharzi, Aḥmad Rûmî, la couleur du vêtement va donc dépendre étroitement de l’état spirituel. Celui qui a immolé son âme charnelle portera du noir (siyâh) ou du bleu sombre (kabûd) en signe de deuil. Ces couleurs se réfèrent à Abraham. Le vêtement blanc est celui des parfaits, il symbolise la pureté extérieure et intérieure et se réfère à Muḥammad. Si quelqu’un, grâce à son haut dessein, a traversé les deux mondes et atteint un haut rang, il portera du bleu clair (azraq). Celui qui est encore soumis à l’instabilité des états et des stations spirituels (ḥâlât, maqâmât) portera un vêtement multicolore (mulammac) (Suhrawardî, 1363 H : 28-31 ; Böwering, 1984 : 72-73 ; Rûmî, 1378 H : 72-78 ; Bâkharzî, 1358 H : 23ss). Le bleu foncé est devenu la couleur la plus répandue chez les soufis. Le noir symbolise l’obscurcissement du cœur par l’âme, le blanc sa purification par le tawḥîd. Le mystique, se trouvant le plus souvent entre les deux, adoptera une couleur intermédiaire (Kâshânî, 1372 H : 151-152). Bâkharzî nous fournit aussi une glose originale sur les couleurs. La manifestation divine induit des états différents selon l’attribut révélé : la Beauté (jamâl), la Majesté (jalâl) et la Perfection (kamâl). Si Dieu se manifeste dans son attribut de beauté, le sujet est dans un état d’expansion (basṭ) et pour éviter d’être irrévérencieux, il doit modérer son élan par le port de vêtements noirs, grossiers et rêches. C’est la station de Jésus. Si c’est la Majesté qui lui apparaît, il subit la constriction (qabḍ) et doit lutter contre la tristesse et la crainte excessives par le port de vêtements blancs et délicats, ou de couleur éclatante (rouge, jaune, vert). C’est la station de Moïse. Si c’est la Perfection qui se révèle, il est en parfait équilibre et portera tantôt du blanc, tantôt du noir, selon son désir. C’est la station du Prophète (Bâkharzî, 1358 H : 28-42).
31Les différents accessoires sont investis eux aussi d’une signification analogique relative à la réalisation spirituelle. Celui qui a acquis la fidélité et la religiosité ajoutera une ganse (farâwiz) à sa robe. S’il a reçu le don de l’amour et de la connaissance divins, il pourra y coudre un ourlet (kursî). S’il s’est revêtu de l’armure et du casque de l’opposition à l’âme concupiscente et à Satan, il pourra y ajouter un col (qabb). S’il est entré en guerre contre son âme, il portera un cilice (khashin). S’il a été blessé mille fois au combat, a bu mille coupes de poison et a été torturé par le désespoir, il portera une robe à mille aiguilles (hazârmîkhî). S’il est passé de l’être au non-être, il portera un manteau léger (labača). Celui qui a enchaîné l’âme concupiscente avec les liens de la Loi l’ornera avec des broderies (ashkâl) et il se drapera dans une cape (ridâ) pour montrer son attachement loyal à la voie. Celui qui n’a plus rien à craindre des créatures portera un turban (dastâr). Celui qui a rejeté derrière lui tout ce qui n’est pas Dieu rejettera le bout de son turban dans son dos. S’il a placé Dieu, l’objet de sa quête, devant ses yeux, il laissera pendre le pan de son turban sur sa poitrine. Celui qui cultive le retrait du monde et l’ascèse nouera un châle (îzâr) autour de son cou. S’il s’est anéanti et a rejoint le monde de la surexistence (baqâ’), ce châle sera noué en lam-alif (premier mot de la profession de foi monothéiste). Il portera un mouchoir (ruy-sitra) devant son visage pour signifier que ses yeux et sa langue ont été délivrés de la tentation du diable. S’il a été éprouvé par l’expérience divine, il portera des chaussettes (jurab). S’il a préservé son pied de la saleté de la disposition naturelle et l’a posé dans le monde de la pureté, il portera des chaussures (pâčîla).
32Le revers du froc est l’épée de la confession de l’unicité de Dieu. L’encolure est un sanctuaire pour les hommes et leurs secrets. La manche est l’arme brandie contre les ennemis. Le bas est le bouclier qui protège les frères. Le couvre-chef est la couronne du charisme et de l’humilité. Le turban signifie que personne n’a rien à craindre du soufi. Le tapis de prière est le signe de la proximité de Dieu. Le bâton est le compagnon dans la solitude, et il repousse le mal. La gourde et l’aiguière sont la source de la pureté et l’abreuvoir de la tempérance. Le sac est la chambre secrète du trésor et le lieu de la connaissance. Les sandales sont le moyen de partir en voyage vers Dieu et de fuir tout ce qui n’est pas Dieu (Kubrâ, 1363 H : 28-31 ; Böwering, 1984 : 72-78).
33Le soufisme visant à la négation de la volonté propre, le maître pourra interdire au disciple le vêtement qu’il convoite. Parfois il le fait changer de vêtements selon son évolution, parfois il le prend avec les vêtements qu’il avait au moment de l’entrée dans la voie sans jamais en changer (Kâshânî, 1372 H : 151-152). Il arrive aussi que l’on revête le même vêtement que le cheikh afin de signifier que l’on a choisi de marcher dans sa voie (Rûmî, 1378 H : 72).
34Le Miṣbâḥ effectue un classement des gens en vertu de la qualité des vêtements. Il discerne deux grandes catégories, ceux qui sont vêtus pauvrement et ceux qui sont vêtus avec plus de recherche. Chacune de ces catégories inclut plusieurs sous-catégories de justes et d’égarés. Les justes habillés modestement s’exercent à l’humilité, à l’ascèse, au détachement des biens de ce monde, recherchent la pureté de la foi et luttent contre leur âme et leurs passions. Par contre, la pauvreté des égarés est hypocrite et calculée. Il y aussi ceux qui sont habillés modestement parce qu’ils n’ont pas les moyens d’avoir mieux, en l’absence de toute motivation spirituelle. Parmi ceux qui sont vêtus avec raffinement, il y a des justes qui connaissent bien leurs limites et voient dans le port d’un vêtement confortable une tolérance vis-à-vis de l’âme, ou qui cherchent à dissimuler leur état spirituel, des parfaits qui n’ont plus rien à craindre et à qui tout est permis, et des égarés qui estiment être arrivés à un tel degré d’élévation spirituelle qu’ils peuvent jouir de ce monde en toute impunité. Certains prétendent être parfaits tout en sachant que cela est faux, et d’autres s’enorgueillissent de leur luxe sans avoir de prétentions spirituelles. Enfin, il y a ceux qui ont abandonné leur libre-arbitre au profit de la volonté divine et qui tirent un même profit du vêtement misérable ou somptueux (Kâshânî, 1372 H : 275-279).
Mariage ou célibat ?
35Certains soufis des premiers temps ont préféré le célibat associé à une ascèse très dure. D’autres spirituels ont critiqué cette attitude, rapprochant le célibat de la vie monastique, rejetée par le Coran comme une invention des chrétiens, et relevant que le Prophète a approuvé le mariage et en a donné l’exemple. Plus tard, le mariage est devenu la règle, sauf pour certains groupes extrêmes comme les qalandars. L’abstinence sexuelle s’est cantonnée aux périodes de retraite (arba cîna) ou de probation. Les auteurs de manuels ont tendance à ne voir dans le mariage que les aspects purement juridiques, pratiques et économiques ; ils n’envisagent pas la relation affective ni l’amour, bien qu’un idéal de mariage blanc avec une femme-ascète se profile, qui rend possible une amitié spirituelle.
36Le mariage est permis à tous ; il est même obligatoire pour ceux qui ne contrôlent pas leurs sens. C’est une coutume prophétique (sunna) pour ceux qui sont capables de subvenir aux besoins d’une famille. Il comporte des avantages et des inconvénients. Les avantages les plus fréquemment cités sont les suivants : s’assurer une descendance, éviter la concupiscence, revivifier l’âme après les rigueurs de la vie spirituelle, fournir une aide ménagère, éduquer l’âme du mari. Ses inconvénients sont la difficulté d’entretenir une famille uniquement avec des choses licites, la difficulté de respecter les droits de chaque membre de la famille, le risque d’être détourné de la dévotion par les soucis matériels, le risque de s’attacher à ce qui n’est pas Dieu, le danger d’un commerce charnel excessif (Hujwîrî, 1371 H : 470ss ; Ghazâlî, 1371 H : 301ss).
37Les inconvénients du célibat sont au nombre de deux : l’inobservance d’une coutume prophétique, et le désir sexuel inassouvi qui risque d’entraîner le célibataire dans des comportements illicites. Le mariage convient plutôt à ceux qui préfèrent vivre dans la société, le célibat à ceux qui recherchent la solitude. Mais, selon Hujwîrî, il est difficile de trouver une femme aimable et sans besoins excessifs, et c’est pourquoi le célibat est préférable. En définitive, ni le mariage ni le célibat ne sont des occasions de chute, à condition de s’en remettre à la Providence et de ne pas décider de soi-même quel état embrasser (Hujwîrî, 1371 H : 470-479).
38Le mariage comporte des obligations et des responsabilités. L’homme doit être aimable avec ses épouses, se mettre à leur niveau et supporter avec patience leur faiblesse d’esprit, tout en gardant son autorité et en ne se laissant jamais entraîner par elles dans des actes indignes. L’homme, en vertu de sa supériorité naturelle, est le maître et le guide de la femme, il lui enseignera le contenu de la foi et les devoirs de la religion. Le mari doit conserver son honneur (ghay-rat), en n’exposant pas sa femme au regard des étrangers, mais sans devenir pour autant soupçonneux. Qu’il fasse les dépenses nécessaires à sa famille sans prodigalité ni avarice et qu’il lui dispense une nourriture licite. Qu’il traite ses femmes équitablement, même s’il en préfère une aux autres. Qu’il les corrige avec modération si nécessaire, mais qu’il ne divorce qu’en cas d’extrême nécessité, sans colère et sans calomnie. L’acte sexuel doit s’accomplir dans le respect de la partenaire, s’accompagner de prières et se terminer par une ablution majeure. Les enfants, filles ou garçons, seront accueillis sans discrimination (Ghazâlî, 1371 H : 301-323).
39Le Miṣbâḥ commence par un constat : les hadiths concernant le mariage et le célibat sont contradictoires ; les uns sont favorables au célibat, les autres au mariage. Ces contradictions découlent de l’existence de différents états des âmes, qui exigent un traitement différent. Le mariage est non seulement nécessaire mais encore indispensable à ceux qui sont dominés par les passions charnelles, dont la piété est faible, ou qui ont peu de patience et d’endurance, car il les aidera à surmonter les épreuves et à éviter la débauche. Par contre, le célibat est profitable à ceux qui débutent leur quête spirituelle et sont pleins d’ardeur, bien qu’encore susceptibles d’être freinés par leur âme charnelle. Le mariage est plus difficile à concilier avec une vie de prière intense. C’est pourquoi il devrait rester l’apanage des hommes supérieurs, dont les âmes se sont affermies dans les épreuves et dont le cœur s’est soumis à Dieu. Au début de la vie spirituelle, l’homme a besoin de se couper de tout intérêt matériel. Le mariage freine et distrait l’effort spirituel, car il impose de subvenir aux besoins de sa famille et donc de composer avec ce bas monde. Au contraire, l’absence de charge familiale favorise la concentration dans la recherche de Dieu, l’obéissance, l’élévation du haut dessein. Le célibataire s’abstiendra de penser au mariage afin de ne pas devenir le jouet de son imagination. Il luttera contre les pensées impures par l’imploration de la miséricorde divine et par le jeûne, et s’en remettra à l’intercession des maîtres et des frères.
40Lorsque le soufi parviendra à un certain degré spirituel, Dieu pourra lui accorder une bonne épouse qui favorisera son progrès spirituel au lieu de l’entraver et le libèrera de certains soucis matériels. Le mariage est profitable à celui dont l’élévation spirituelle est capable d’influer positivement sur une autre âme. Dans le choix d’une épouse, la religiosité de celle-ci doit avoir le pas sur les considérations humaines et mondaines. Qu’il respecte ses droits et les limites que lui impose la Loi. Qu’il se garde de trois vices : trop de commerce avec elle, ce qui excite l’âme charnelle, trop de souci de ses moyens de subsistance, ce qui dénote un manque de confiance en Dieu, un attachement intérieur à la beauté de la femme, ce qui est une sorte d’idolâtrie (Kâshânî, 1372 H : 254).
41Les auteurs de manuels étudiés ici appartiennent à la tendance modérée du soufisme. Même s’ils sont très admiratifs vis-à-vis des glorieux précurseurs dont ils rapportent les exploits, ils écrivent pour des communautés soufies soit informelles soit organisées en confréries, dont tous les membres ne sont pas des athlètes spirituels. Ils ne cherchent donc pas à leur imposer des mortifications exceptionnelles qui, de toute manière, ne pourraient être assumées que par une petite minorité. Leur doctrine est caractérisée par le juste milieu, et la règle de vie qu’ils proposent est accessible à tous dans la mesure où seuls les excès sont prohibés. L’idéal est la simplicité et une pauvreté modérée. L’adepte peut donc se nourrir normalement, dormir un nombre d’heures suffisant, se vêtir correctement, se marier, avoir une vie sociale.
42Cette évolution est caractéristique de toute mouvance religieuse qui s’ouvre à de plus nombreux adeptes et s’organise en communauté. On la retrouve dans le monachisme chrétien dans le contraste entre l’anachorétisme s’illustrant par un ascétisme extrême, et le cénobitisme se caractérisant par une règle modérée qui va en s’adoucissant : la règle de saint Benoît tempère celle de saint Basile qui est déjà moins rigoureuse que celle de Pacôme.
43Dans les traités étudiés, le savoir-vivre, les règles de comportement s’avèrent plus importants pour la maîtrise du corps que les exploits ascétiques. L’adab est présenté comme exclusivement inspiré par la Loi révélée dans le Coran et l’exemple du Prophète. Ce savoir-vivre devrait être celui de tout musulman. Les soufis forment l’élite spirituelle de la Communauté musulmane, parce qu’ils le respectent mieux que quiconque. Il y a coïncidence entre l’état spirituel et les conduites quotidiennes : le comportement public du soufi doit correspondre à ce qu’il vit intérieurement, et inversement ses actes les plus banals influent sur son expérience intérieure. Le moindre manquement aux règles du savoir-vivre engendre donc une tare dans la foi. C’est pourquoi les actes de la vie quotidienne sont réglementés. C’est la nourriture, souvent prise en commun, qui a inspiré le plus grand nombre de textes, sans doute à cause de sa forte dimension sociale. En ce qui concerne les privations, elles doivent s’accorder avec l’état intérieur, sous peine d’être inutiles, voire nocives et dangereuses. Les veilles et les jeûnes excessifs ne conviennent pas aux débutants, qui risquent de sombrer dans une autosatisfaction orgueilleuse, de confondre le moyen avec le but, ou de se décourager. Les différents types d’ascèse vont de pair et s’épaulent mutuellement : la veille ou le célibat ne se conçoivent pas sans une alimentation adaptée. Enfin la purification passive, don de Dieu, est considérée comme supérieure à la purification active où la volonté propre joue un rôle décisif. Or le soufi lutte précisément pour anéantir la volonté propre, afin que Dieu seul veuille en lui. Lorsqu’il parvient à la réalisation spirituelle, il devient, à l’image de Dieu, libre de toute contrainte. Peu importe alors qu’il se mortifie ou mène une vie normale. Quoi qu’il fasse, il est en Dieu.